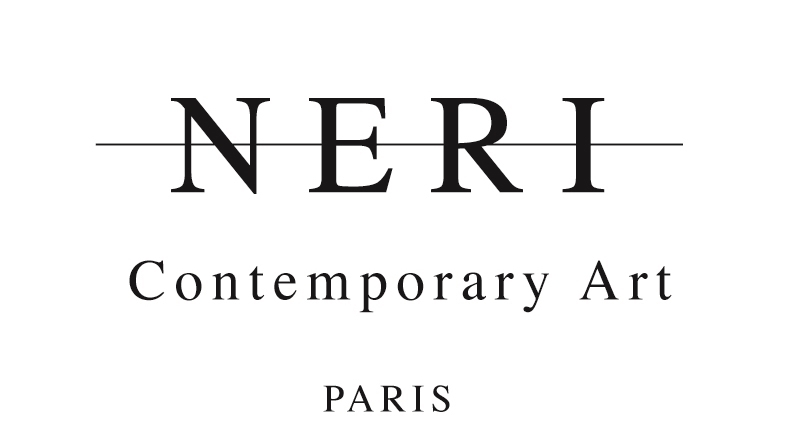L'ESTHETIQUE DANS L'ART CONTEMPORAIN : ENTRE CREATION ET DERANGEMENT
Silvia Neri : Dans mon travail théorique que ce soit comme chercheuse ou commissaire d’exposition, je me questionne souvent sur ce qu’est la création artistique aujourd’hui...
Sandrine Métriau : Par rapport à mon travail, ça m'est déjà arrivé de créer quelque chose et de sortir quelques de beau. Enfin, la dernière œuvre que j'ai fait pour l'été dernier, c'était une œuvre qui était faite à partir de de de farine de terre et d'eau. Enfin clairement sur l'esthétique premières de la chose. C'était clairement un truc boueux sale, enfin clairement c'était sale et l'esthétique finale était pas... il y avait un côté pas beau, tu vois le fait que ce soit sale et en fait même moi ça m'a dérangé alors que du coup ça n’aurait pas dû parce que c'était assez réfléchi et genre enfin la forme finale pour moi était pas déterminée parce que toute façon je laisse toujours la matière dictée ce qu'elle veut faire. Mais en fait ça m'a dérangé d'avoir ce rapport là à mon travail, de me dire Bah j'attendais que ce soit beau et en fait ce n’est pas beau parce que j'ai associé en fait de la terre, le l'eau, là la boue au sale et donc du coup le rendu final ne plaît pas parce que cette association-là est pas. Enfin je ne sais pas comment expliquer mais. Un peu un peu bizarre.
SN : Je ne sais pas, moi, si je ne vais pas constamment exposer des choses belles. Tu vois ce que je veux dire ? Bien sûr, j’ai déjà montré quelques œuvres qui sont esthétiquement agréables, plaisantes à l'œil. Mais ce n’est pas toujours le cas. Finalement, est-ce que la beauté est vraiment un critère essentiel pour définir l’art ?
Emilio Chioffalo : L’art contemporain n’est pas nécessairement lié à la beauté...
SN : Mais oui, c’est ça ! A ce sujet, j'ai regretté d'avoir jamais vu ton œuvre Sandrine, celle que tu a exposé à l'hôpital. Le concept était incroyable.
SM : Ouais, l’exposition dans l’hôpital désaffecté qui avait été présentée dans le Morvan.
SN : Déjà le processus était intéressant... Tu avais demandé sur Facebook des dons de cheveux…c’est ça, non ?
SM : Je m'étais posé la question suivante : que laisse chaque personne qui est à l'hôpital ? Finalement, quand tu arrives dans cet endroit, tu n’as pas forcément envie d’y être. Tu passes, et puis tu repars. Mais qu'est-ce que tu peux laisser malgré toi dans un hôpital, même si tu n'as rien laissé de visible ou tangible ? En fait, tu n'as pas choisi d’y être, car généralement, on ne va pas à l'hôpital par envie ou par plaisir. Donc je cherchais vraiment quelque chose que l'on laisse malgré soi dans cet endroit, pas spécifiquement, mais dans ce lieu en général. Quelle est cette chose que l'on laisse involontairement ? Et la réponse fut : des cheveux. Je me suis dit que toutes les personnes qui passent laissent forcément des cheveux, dans n’importe quel hôpital. C’était très intéressant, car ça m'a fait penser : c'est vrai, tout le monde laisse des cheveux. Moi, je vais créer une sorte de masse avec de la colle, puis je vais en faire des fils. Ensuite, je tricote le tout pour en faire une belle boule que je suspendrai. Et là, j'étais devant en mode "ouais". Tu ne m'avais pas encore expliqué cette idée des cheveux, tu vois ? Oui, tout le monde dit : "Je veux une grande boule", et après les gens pourront l’arroser. Et la colle va... En fait, c'est un bioplastique. Ce sont des plastiques qui se dégradent au contact de l'eau et de la terre. En fait, j'avais fait deux sortes de cocons, et les gens avaient un arrosoir pour arroser les cocons dans la pièce, afin qu’ils se délient et qu’il ne reste que des cheveux.
EC : Cette question revient souvent, notamment lorsqu'il s'agit de travailler sur l'objet, sa matérialité, et son essence. A la Bourse de Commerce, il y avait d'ailleurs une œuvre qui abordait ce thème. Il s’agissait de nonnes qui, en signe de dévotion lorsqu'elles rejoignent un ordre religieux, se coupent les cheveux. Il paraît même qu’elles les vendent. L’artiste avait récupéré ces cheveux et en avait fait une œuvre : une sorte de boîte transparente en plastique, contenant ces cheveux oxygénés, devenus blancs, qui flottaient dans un liquide ressemblant à de la colle. Cette œuvre a été achetée par la suite.
SN : Je veux dire, esthétiquement, je n'ai pas vu cette œuvre, mais l'idée est vraiment géniale. Par contre, sur le plan esthétique, je ne sais pas trop quoi en penser. Les cheveux qui plongent et se mélangent peuvent aussi être dérangeants. Ah, je pense qu'un cheveu, c'est toujours un peu dérangeant. Par exemple, quand tu as un cheveu ici, il y a des gens qui te le retirent, et cela peut vraiment être dérangeant. En même temps, je trouve ça très poétique. C'est comme arroser pour détruire, pas pour donner la vie, c'était à l'envers, tu vois ? C'était super.
SM : Et puis même en plus le principe hein, oui comme tu dis les cheveux ça dérange. Et en plus moi quand j'ai parlé de ce projet-là, chaque fois il y avait ce côté un peu “dégout” tu vois genre ah mais t'as plein de choses différentes à des gens différents qui se mélangent et tout. Et comme je les tricote, bah du coup j'étais au contact. De la matière, hein ? J'avais le contact avec plusieurs personnes et ça dégoûtait les gens, mais moi ça allait en fait.
Bibliographie
Adorno, Theodor W., Théorie esthétique. Klincksieck, 1974.
Badiou, Alain, Petit manuel d’inesthétique. Seuil, 1998
Benjamin, Walter, L'œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique. Allia, 2013.
Bourriaud, Nicolas, Esthétique relationnelle. Presses du réel, 1998.
Danto, Arthur C., The Abuse of Beauty: Aesthetics and the Concept of Art. Open Court, 2003.
Deleuze, Gilles, et Félix Guattari, Mille Plateaux. Editions de Minuit, 1980.
Dewey, John, L’Art comme expérience. Gallimard, 2010.
Eco, Umberto, Histoire de la beauté. Flammarion, 2004.
Kant, Immanuel, Critique de la faculté de juger. 1790.
Lippard, Lucy, Six Years: The Dematerialization of the Art Object. University of California Press, 1997.
Rancière, Jacques, Le Partage du sensible: esthétique et politique. La Fabrique, 2000.
Shusterman, Richard, L’Art à l’état vif: la pensée pragmatiste et l'esthétique populaire. Editions de Minuit, 1992.